
La transformation technologique sans précédent qui se déroule en ce moment – une période de changements exponentiels appelée la quatrième révolution industrielle – n’est pas isolée des affaires géopolitiques.
En effet, la concurrence géopolitique, notamment parmi les puissances mondiales, est un facteur majeur de rupture technologique, qui, à son tour, affecte le paysage géopolitique.
La technologie a longtemps été une composante de la façon dont les États gagnent, utilisent ou perdent leur pouvoir. Mais aujourd’hui, trois éléments inter reliés – l’innovation, le talent et la résilience – déterminent toujours plus si les États sont bien placés pour faire progresser leur sécurité et leur bien-être.
1. L’innovation reste un pouvoir
Les États savent que le leadership en matière d’innovation technologique se traduit par une puissance économique et militaire et, par conséquent, par un pouvoir géopolitique. En tant que telle, la concurrence mondiale pour le leadership du secteur technologique est intense, non seulement en raison des avantages économiques évidents, mais aussi en raison des gains potentiels en matière de sécurité que peut apporter la technologie. Cette concurrence féroce incite les États à investir dans l’innovation et continue de jouer un rôle essentiel dans la production et la mise à l’échelle des technologies de pointe.
Les craintes d’être laissées pour compte sur le champ de bataille (au sens littéral du terme) sont l’une des principales raisons pour lesquelles les grandes puissances mondiales dépensent beaucoup dans les technologies émergentes. Ils espèrent se procurer sécurité et puissance dans un monde incertain. Pendant des décennies après la Seconde Guerre mondiale, par exemple, le gouvernement américain a dépensé des milliards de dollars dans son écosystème de recherche scientifique et technique (ce dont la Silicona Valley a de toute évidence largement bénéficié), par crainte de perdre la guerre froide sinon. Cet écosystème, qui combinait la recherche scientifique avec l’aplomb entrepreneurial, a permis aux États-Unis d’obtenir un avantage décisif tout au long de la guerre froide et longtemps après.

Le développement technologique a joué un rôle évident dans la guerre. La mitrailleuse Maxim, le canon rayé, l’avion, le gaz toxique, le napalm et les armes nucléaires ne représentent qu’une infime fraction de la multitude d’inventions modernes sur les champs de bataille. À plus long terme, les inventions issues des progrès de la nanotechnologie, de la biotechnologie, de l’intelligence artificielle et d’autres domaines vont bouleverser la guerre, de la logistique à l’armement. Comme toujours, la plus importante de ces inventions conférera un avantage géopolitique (temporaire) aux premiers acteurs à la mettre en œuvre. Et, comme toujours, une fois inventés, les inventions ne peuvent plus être dés-inventées – l’humanité devra vivre avec elles éternellement.
2. Le talent, c’est le pouvoir
Comme le signalent chaque année des organisations comme l’ Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et, tout récemment, cet auteur et ses collègues de l’Atlantic Council, la majeure partie des technologies nouvelles et perturbatrices du monde sont produites dans une poignée de pays. Les sociétés qui parviennent à créer ou à attirer des masses critiques de talents (inventeurs, entrepreneurs, scientifiques, ingénieurs, chercheurs) et à leur donner les outils et l’environnement nécessaires pour être créatifs figurent, à long terme, en tête.
Bien qu’il n’existe pas de modèle unique pour un environnement technologique performant, tous les exemples combinent des investissements publics dynamiques dans la recherche et le développement scientifiques, un système éducatif de grande qualité, un accès relativement aisé aux investissements et au capital-risque, et la protection de la propriété intellectuelle.
Comprenant la concurrence mondiale intense dans ce domaine, les décideurs de divers pays ont copié et, dans certains cas, amélioré le modèle américain en l’adaptant à leurs propres fins. Les recherches scientifiques de haute qualité ne se poursuivent pas exclusivement aux États-Unis : tous les leaders de l’innovation investissent une part substantielle de leur PIB dans la R&D. Israël et la Corée du Sud sont actuellement les leaders mondiaux en la matière, chacun investissant plus de 4% par an en R&D.
Presque tous les candidats sérieux au leadership en matière d’innovation améliorent leurs systèmes de transfert de technologie entre l’Université et l’entreprise, une force de longue date du système américain. Beaucoup, sinon la plupart, conçoivent un environnement propice à la création et font venir des personnes talentueuses de l’étranger. Start-up Chile, créée en 2010, est un accélérateur public qui offre aux entrepreneurs de partout dans le monde un visa de travail d’un an, un financement d’amorçage, une formation, du mentorat, etc. Ce modèle a depuis été copié par de nombreux autres pays.
Bien que les États-Unis demeurent le leader mondial de l’innovation technologique, d’autres pays gagnent rapidement du terrain. Dans un rapport publié l’année dernière, cet auteur et ses collègues de l’Atlantic Council ont fait valoir que, si d’autres pays sont en hausse, les États-Unis doivent partager la responsabilité de leur déclin relatif. Les décideurs politiques américains ont laissé s’éroder plusieurs facteurs d’innovation irremplaçables. La qualité de l’infrastructure américaine, par exemple, a considérablement diminué, les standards du XXIe siècle n’ayant pas fait l’objet d’une considération suffisante.
D’autres investissements publics ont également diminué, et en particulier le plus important d’entre eux — le financement de l’enseignement supérieur et de la recherche publics — c’est-à-dire la source de la science fondamentale qui sous-tend tout développement technologique. Il va sans dire que le climat politique actuel aux États-Unis en matière d’immigration est aux antipodes de l’objectif d’attirer et de retenir les meilleurs talents mondiaux.
3. La résilience est le pouvoir
Les systèmes innovants créent des technologies améliorant la productivité qui, à long terme, profitent à la société. Cependant, de nombreuses personnes sont mises de côté par ce mouvement, car elles vivent dans des régions affectées par les perturbations technologiques et / ou parce qu’elles n’ont pas les compétences requises pour y participer. Ignorer cette réalité rend impossible la création d’une économie robuste et d’une société saine.

Certaines sociétés sont mieux placées que d’autres pour bénéficier à la fois d’une technologie de rupture et en limiter les impacts négatifs. Les plus grands innovateurs du monde ont souvent investi le plus dans des stratégies basées sur la résilience et conçues pour optimiser les chances de leurs citoyens de bénéficier des changements malgré leur effet perturbateur. Cependant, la question est de savoir si ces sociétés sont suffisamment bien préparées à la quatrième révolution industrielle.
La réponse probable est négative, et nous pouvons nous attendre à plus de bouleversements à l’avenir. L’absence de mécanismes inventifs conçus pour relever les défis économiques et politiques résultant des perturbations technologiques risque de fortement déstabiliser les sociétés.
À mesure que les technologies perturbent les industries et modifient ou éliminent des catégories entières d’emplois, les États devront adapter leurs systèmes d’éducation, d’emploi et de protection sociale. La mauvaise nouvelle, c’est que les systèmes (plutôt) confortables conçus pour l’ère industrielle supérieure ne constituent plus des modèles pour l’avenir.
La bonne nouvelle, c’est qu’il existe un espace considérable pour l’innovation politique et l’expérimentation. Les gouvernements qui traitent leur force de travail nationale comme leur plus grand atout en bénéficieront à long terme. Investir dans une éducation de qualité, la formation et la mise à niveau des compétences tout au long de la vie, et un filet de sécurité sociale souple mais robuste, s’avérera rentable pour les pays disposés à le faire. C’est un domaine où les États-Unis, en tant que leader mondial de l’innovation, risquent de prendre du retard : l’enseignement universitaire y coûte de plus en plus cher, son système de formation est très en retard sur celui de leaders comme l’Allemagne et son filet de sécurité sociale est vraiment très faible.
La gouvernance mondiale sera un défi
Comme lors des précédentes révolutions, les technologies issues de la quatrième révolution industrielle arrivent bien en avance sur les règles et normes nécessaires pour les réguler. Il n’y a pour ainsi dire pas de consensus mondial sur la nécessité éventuelle et la manière de réglementer l’impact des technologies.
Pour élaborer un régime de réglementation technologique mondial solide et applicable, il doit y avoir assez de preuves qu’une technologie spécifique présente suffisamment d’inconvénients pour nécessiter une surveillance. Il y a très peu de chance que de telles preuves existent au moment de l’invention de la technologie. Par exemple, les scientifiques ont mis des décennies à découvrir que les chlorofluorocarbures (CFC) détruisaient la couche d’ozone. Même si une technologie a clairement des répercussions négatives, comme c’est souvent le cas avec les nouvelles technologies guerrières par exemple (pensez aux armes nucléaires), les accords mondiaux visant à limiter leur utilisation requièrent la volonté politique des États d’y participer. Plus important encore, cela nécessite la participation des grandes puissances, qui, par coïncidence, sont souvent les moins incitées à jouer.
Le résultat est un système mondial dans lequel les incitations s’alignent sur la création et la diffusion de nouvelles technologies – y compris les technologies mortelles – mais pas au sujet de leur supervision. Bien que chaque génération soit confrontée à cette réalité, les risques augmentent parce que les technologies deviennent plus puissantes avec le temps. Dans le domaine militaire, une plus grande puissance signifie une plus grande létalité : le mousquet et la bombe à hydrogène sont deux techniques dont les effets sont très différents de ce point de vue. Et même lorsque les nouvelles technologies apportent des avantages économiques ou sociaux, comme dans le cas des CFC, elles peuvent souvent créer de mauvaises surprises.
C’est pourquoi la gouvernance intelligente de la technologie au niveau mondial fait partie des tâches les plus importantes auxquelles nous serons confrontés au cours de ce siècle. Malgré les difficultés à élaborer de solides régimes internationaux de gouvernance technologique, il est impératif que les gouvernements s’y attellent.
Les négociations bilatérales entre les principales puissances sur une série de questions liées à la technologie peuvent avoir un effet réel et productif sur la gouvernance, compte tenu de leur importance pour l’économie mondiale et pour la production technologique. Il en va de même pour les forums multilatéraux tels que l’Organisation mondiale du commerce, le Groupe des vingt (G20), l’OMPI, l’Union internationale des télécommunications (UIT) et bien d’autres encore.
Bien que la politique rende très difficile et parfois impossible pour de telles organisations de créer des règles mondiales robustes et applicables, les États peuvent y faire appel pour développer de nouvelles normes pour des questions telles que l’ingénierie génétique ou l’intelligence artificielle.
En collaboration avec le WORLD ECONOMIC FORUM
https://www.weforum.org
Retrouvez l’article original ici.












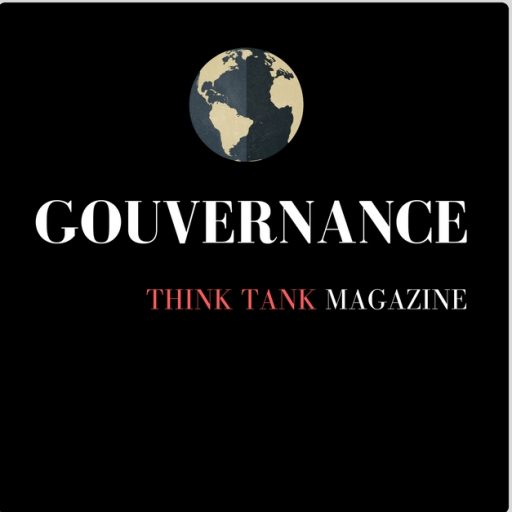 Gouvernance.news, est un media Think Tank qui a pour ambition d'être une plateforme des initiatives de bonnes gouvernance dans tous les domaines. Il s'agit de mettre en lumières les bonnes idées d'ici et d'ailleurs afin de s'en inspirer.
Gouvernance.news, est un media Think Tank qui a pour ambition d'être une plateforme des initiatives de bonnes gouvernance dans tous les domaines. Il s'agit de mettre en lumières les bonnes idées d'ici et d'ailleurs afin de s'en inspirer.
Vos réactions